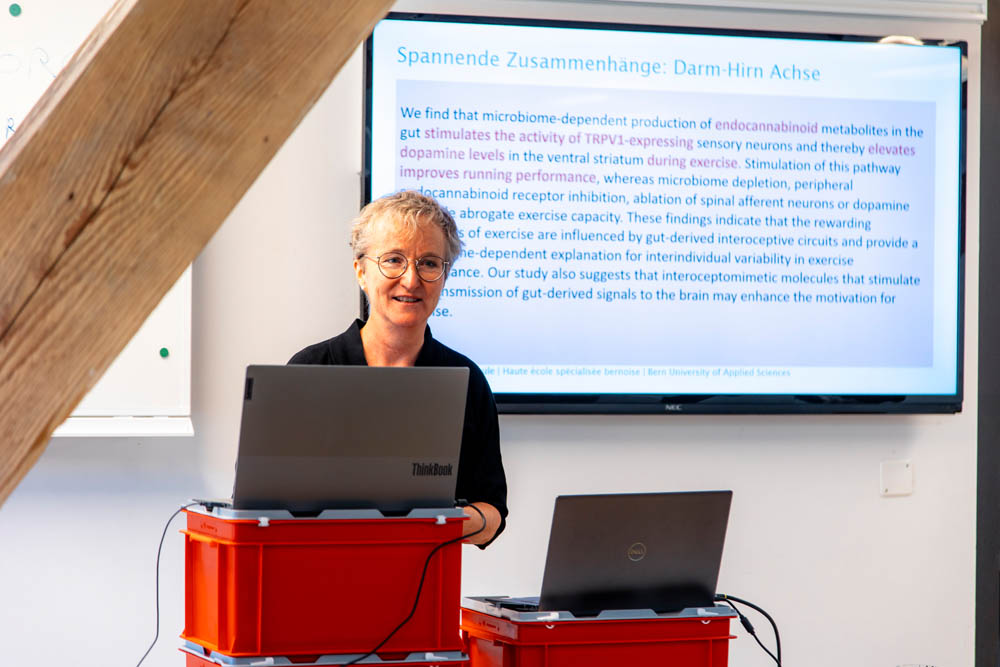Il est souvent dit que vouloir changer le monde est utopique, une belle idée irréaliste. Nous avons pourtant vécu dans les pays occidentaux une transformation complète de la société depuis les années 60, avec un renversement dans la quasi-totalité des domaines de la vie.
J’aurai toujours comme référence pour ma vie le film américain « le Cercle des poètes disparus »1 : faire sauter les verrous, les carcans pour entrer dans un chemin de liberté propre à soi ; vivre la vie en se centrant sur l’essentiel, quitte à déranger.
La révolution de la Contre-culture
Nous étions auparavant, avant les années 60, dans une société autoritaire où la position de l’élu dès l’échelon de maire ou syndic, de l’enseignant, du médecin, du pasteur ou prêtre, de l’officier militaire, du chef de famille, du juge, du policier et des institutions en rapport les plaçaient sur un piédestal. La femme mariée avait un statut équivalent à une personne sous curatelle dans le droit matrimonial de cette époque depuis des générations. Les églises exerçaient un rôle de conduite morale reconnu dans la société en Suisse et il valait mieux être de la confession de son canton de résidence pour ne pas être l’objet de rejet, en particulier dans les villages. Il valait mieux ne pas discuter longtemps face aux personnes en charge des responsabilités qui présentaient la réalité comme étant tel qu’ils l’énonçaient et pas autrement … même quand ils se trompaient. C’était une société caractérisée par un ordre établi peu contestable.
Provenant du Siècle des Lumières (18ème siècle), les libertés fondamentales s’étaient pourtant établies progressivement dans les Etats européens depuis le 19ème siècle : libertés politiques d’expression, de presse, de réunion, d’association, l’idée d’égalité.2 Depuis la Renaissance et la Réforme déjà, le courant pluraliste s’ouvre : retour aux auteurs et à l’architecture de l’Antiquité, plusieurs confessions chrétiennes présentes coexistant désormais si on compte les luthériens, les anglicans, les anabaptistes en plus des réformés et des catholiques ; accès à l’éducation.
A partir des années soixante s’amorce progressivement un renversement de la société autoritaire. C’est une véritable révolution réussie, durable dans ses effets et sans violence à laquelle on assiste. En Europe Mai 68 en est l’origine, aux Etats-Unis on parle de la Contre-culture. En effet on va faire l’inverse d’avant dans quantité de domaines : émancipation et affirmation de l’égalité des droits des femmes, des noirs, des minorités sexuelles, pluralisme spirituel avec l’ouverture aux spiritualités orientales et à l’ésotérisme, démocratisation de l’enseignement, des études, de la police (son rapport aux citoyens changé), prise de conscience écologique, réforme et diminution des effectifs de l’armée en Suisse avec introduction du service civil. La même époque voit l’indépendance des pays colonisés par les puissances européennes 3 et une plus grande considération des peuples autochtones non blancs et des pays du Sud du globe.
Sur le plan de la famille, le nombre de divorce augmente considérablement, l’avortement est légalisé et s’étend, la norme pénale sur l’adultère est abolie en Suisse en 19904.
En 1989 les pays d’Europe centrale et de l’Est sous domination communiste se libèrent à la chute du Mur de Berlin, autre étape clé du processus de libéralisation : 90% des pays d’Europe vivent ou aspirent à être des démocraties libérale l’année même des festivités du bicentenaire de la Révolution française.
La relation avec la foi
La foi chrétienne est associée à la culture que l’on veut contrer et mettre derrière, ce qui entraîne l’engouement pour les spiritualités alternatives à partir de ces années-là5. En lisant Luc Ferry, philosophe français, une notion fondamentale en ressort : Mai 68 va tendre à effacer dans la pensée l’idée de vérité et d’objectivité. Cette thèse est soutenue en affirmant que dans la pensée de Mai 68, une opinion, une conviction ou un exposé théorique partent d’une origine, d’un profil, d’un arrière- plan. C’est l’influence par contacts avec tels milieux et idées, l’historique et la culture propre, voire de l’inconscient de la personne ou groupe de personnes qui définissent le positionnement. Donc il y a déconstruction de l’idée d’objectivé et de la vérité et par là de l’absolu. On ne conçoit ou cerne plus par la question « qu’est-ce que » (c’est) ? mais de « qu’est-ce qui » (est derrière) ? … « D’où tu parles ? » était souvent entendu lors de Mai 68 …6
Pour nous chrétiens c’est par là même la notion de foi qui est contestée puisque la foi repose justement partiellement sur l’invisible (Hébreux 11), le mystère, de même que sont mises en doute la notion de Vérité, et celle des vérités dans les divers domaines de la vie en fonction d’un référentiel modèle qui est la révélation biblique. Cela explique le développement à l’extrême du pluralisme en politique, en éthique, en spiritualité, sur Internet, on pourrait même dire jusqu’aux fakes news et au complotisme. Tout se vaut et se défend. La notion de vrai ou de faux s’estompe. Avec les nouvelles spiritualités, toutes sortes de systèmes et types de spiritualités apparaissent.
La Contre-culture serait-elle de droite ?
Jusque-là on acceptait qu’une part des entreprises relevaient de l’Etat et qu’une réglementation limitée était fixée comme condition- cadre à l’économie, en prenant ici comme exemple la Suisse. A partir des années 90 et la chute du Mur de Berlin, on assiste à des privatisations comme celle de Swisscom ou des Chemins de Fer Fédéraux et à une déréglementation visant à ‘’fluidifier l’économie’’ (comme la libéralisation du travail du dimanche). Le Livre blanc de David de Pury en partie réalisé est un bon illustrateur de ce phénomène des années 90 7 dans la vague de l’Uruguay Round de l’OMC et de la mise en place de la libre circulation des biens, capitaux, services et personnes dans l’Union européenne.
Luc Ferry déclare même que le changement de société n’est pas dû à Mai 68 et ses leaders comme Daniel Cohn-Bendit mais induit par le libéralisme économique qui a cassé les codes (comme en architecture moderne)…thèse intéressante : « En réalité, ‘les contestataires’ revendiquaient le droit au plaisir et aux loisirs, en quoi Mai 68 s’est inscrit dans la longue histoire de la révolte libérale- libertaire des individus contre ces autorités et ces valeurs traditionnelles qui avaient l’inconvénient majeur de freiner l’accès à la jouissance et à la consommation. (…) Il fallait que les valeurs traditionnelles fussent liquidées pour que le capitalisme mondialisé pût s’épanouir. Si nos enfants avaient conservé les mœurs de nos arrière-grands-parents, il est clair qu’ils ne courraient pas après les gadgets qu’on leur fourgue à jet continu sur Amazon. En d’autres termes, sous les pavés, il n’y avait pas de plage8, mais les exigences de l’économie libérale. »9
Comment se positionner face à Mai 68
Beaucoup de changements peuvent être encouragés voire portés par les chrétiens en fonction de la Bible comme le changement de statut des femmes, des noirs, la prise de conscience écologique, les verrous d’autoritarisme qui sautent dans les rapports dans la société, voire la lutte contre l’homophobie. Un vent de liberté a soufflé et on peut reconnaître comme bon et c’est profitable d’être dans une société libre pour vivre sa foi, donner son opinion, avoir son identité personnelle et de groupe respectée.
Maintenant pour ce qui est du Mariage pour tous, la pleine reconnaissance des identités LGBT, l’avortement, la théorie du genre, il y a contradiction avec l’éthique biblique.
L’affirmation souvent exprimée que nous assistons à une perte des valeurs est à relativiser, les luttes et les revendications qui trouvent racine dans les années 60 et 70 portent encore une fois des valeurs souvent positives comme la préservation de la Création ou la lutte contre le racisme. On peut en revanche admettre cette affirmation par exemple concernant l’avortement : « Pro choice » veut dire que la conséquence de la liberté sexuelle n’est pas d’assumer la responsabilité de l’enfant qui peut être conçu et ouvre ainsi à une nouvelle liberté individuelle de choisir ou non de garder un enfant en gestation, or la liberté bibliquement parlant c’est entrer dans une responsabilité envers autrui (Galates 5,13 et suivants). Nous sommes dans une société post Mai 68 où l’individu ou un groupe peut déterminer ses propres valeurs comme à la suite des Lumières c’était l’Etat et la société dominante qui les définissait et progressivement de moins en moins Dieu et la Bible. Ce qui conduit à vivre avec une multitude d’opinions, de théories, de références, phénomène accru avec Internet.
La démocratie libérale est en effet un système politique qui porte bien son nom : à la fois sur le plan politique et économique, nous disposons de beaucoup de libertés.
Nous replacer face à notre origine.
En tant qu’enfants de Dieu, nous vivons dans la révélation que l’être humain tend intérieurement à une totale indépendance depuis l’accès à l’arbre de la connaissance du bien et du mal, le tentateur lui indiquant qu’il sera comme un dieu (Genèse 3). Par les facultés que Dieu a donné à l’humain, celui-ci peut en effet aller loin par la réflexion, les choix, un mode de vie et l’exercice de toutes les activités existantes dans la société et donc en conséquence établir un monde qui fonctionne. Nous pouvons l’observer au regard de l’évolution de nos nations occidentales depuis plus de 2 siècles (depuis les Lumières et l’industrialisation) qui ont même atteint un degré de développement matériel, scientifique et d’influence plus important que l’ère plus « spécifiquement chrétienne » précédente, du moins jusqu’au début de ce siècle. L’homme et la femme de foi en cultivant la relation avec Jésus-Christ par son Esprit, par sa Parole et d’autres supports vivants cherchent – individuellement et en collectif- en toute choses ce qui est juste (1 Thessaloniciens 5,21 ; 1 Corinthiens 2, Psaume 1), même dans une démarche humaine restant très imparfaite. Nous devons sans cesse à nouveau relever le défi de nous aligner à la pensée de Dieu malgré nos limites dans ce domaine. Nombres de textes mettent l’accent sur la justice et s’opposent à la domination et à l’exploitation (ex. Jérémie 22,3). Notre mission est de poursuivre ce désir de justice sans perdre de vue le Seigneur, et sa folie à lui la croix avec ce qu’elle établit comme valeurs du Royaume qui sont aimer ses ennemis, bénir ceux qui nous persécutent (Matthieu 5), considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes et leurs intérêts avant les nôtres (Philippiens 2), sans déni de l’écart relevé dans la pratique entre cet idéal fou avec ce que nous sommes.
J’aurai toujours en tête le film « le Cercle des poètes disparus », dans ce désir fou de libération de ce qui nous entrave institutionnellement et de par les mentalités ambiantes, mais dans une recherche de conserver les yeux sur Dieu révélé en Christ et malgré les écarts dans la progression à son image.
1. Le Cercle des poètes disparus, de Peter Weir, avec Robin Williams, Robert Sean Leonard, Kurtwood Smith, Ethan Hawke, 1989 https://www.imdb.com/title/tt0097165/?ref_=fn_al_tt_1
2 Mais il y a en début de processus une résistance aux idées libérales avec pour exemple le refus par référendum en Suisse en 1866 de la liberté de conscience, du droit de vote en matière communale et cantonale pour confédérés résidant en dehors de leur canton d’origine, avec du bout des lèvres l’autorisation d’établissement (immigration) de personnes de confession juive. https://www.slatkine.com/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=5543-p.5–7
3 Mettant partiellement fin au colonialisme toutefois
4 Genève avait déjà supprimé le délit d’adultère en 1874 (avant l’unification du code pénal sur le plan fédéral). Ce qui n’empêche que le Code civil suisse exige toujours de nos jours la fidélité en époux (art. 212) et conçoit la relation conjugale comme exclusive, faisant encore de l’adultère un acte illicite même que non condamnable pénalement. Parler sans fondement de quelqu’un comme ayant commis un adultère reste considéré sur le plan pénal comme une atteinte à l’honneur (diffamation). https://www.20min.ch/fr/story/l-adultere-reste-un-acte-illicite-en-suisse-246498216429
A noter encore que jusqu’en 1965 en Suisse seules les femmes ayant commis l’adultère étaient condamnables … et non les hommes ! On était encore 2000 après dans le récit évangélique de la femme adultère (Jean 8).
5 Le Livre des sagesses, sous la direction de F. Lenoir, Bayard 2002, article sur l’ésotérisme occidental.
6 Luc Ferry, Alain Renaut, La Pensée 68, Gallimard, 1988, p.43 à 49 sur la généalogie et la dissolution de l’idée de vérité
7 https://fr.wikipedia.org/wiki/David_de_Pury_(%C3%A9conomiste)
8 Un des slogans de Mai 68 était « Sous les pavés … la plage »
9 Luc Ferry « Penser enfin Mai 68 », article paru dans le Figaro du 15 février 2018; faisant référence à son ouvrage « La Pensée 68 » op.cit.
Photo © Donation Gilles Caron, Ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie