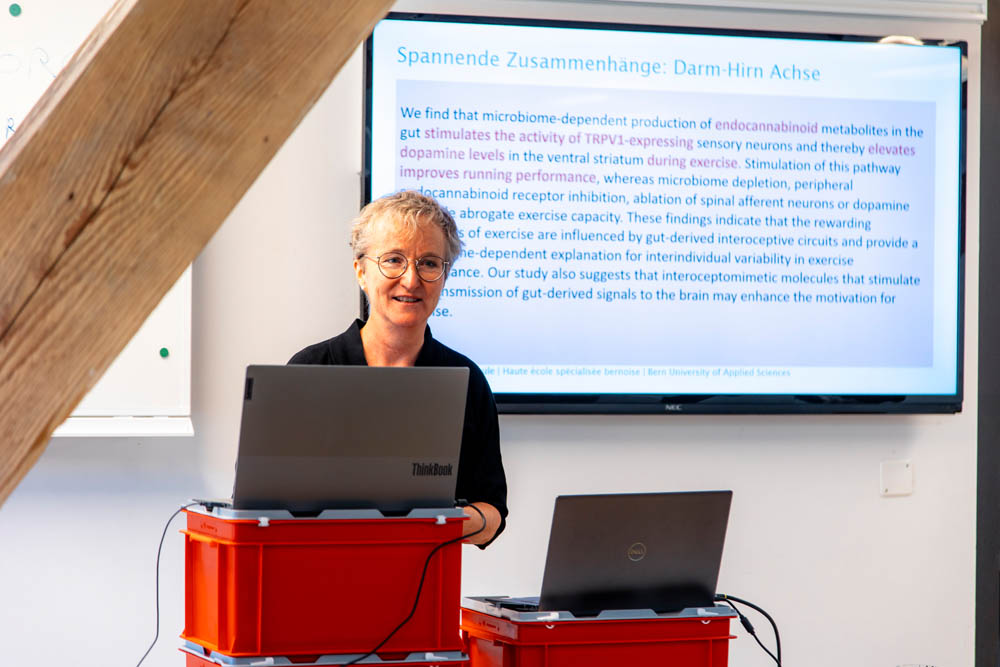~ 6 minLa droite ou la gauche déterminent notre pensée et notre action politiques. Est-ce encore pertinent pour répondre aux exigences actuelles de la politique ? Ou faudrait-il là aussi changer de mentalité pour trouver des solutions aux problèmes complexes ?
La répartition parlementaire droite-gauche des sièges détermine le discours politique des temps modernes. Comment en est-on arrivé là ? Pendant la Révolution française, le placement spatial de la « droite » et de la « gauche » a été chargé politiquement pour former un système d’ordre politique qui promettait une vue d’ensemble dans les bouleversements révolutionnaires à partir de 1791. La nouvelle Assemblée nationale a placé les aristocrates/monarchistes conservateurs à droite et les patriotes révolutionnaires à gauche.
Depuis, cette répartition des sièges fait office de nomenclature pour tous les partis du parlementarisme démocratique. Elle détermine le débat politique jusqu’à aujourd’hui, bien que – et c’est l’occasion des réflexions suivantes – les lignes de démarcation entre « gauche » et « droite » ne soient plus claires depuis longtemps en termes de programme.
Des catégories anachroniques
De plus en plus de voix s’élèvent pour dire que les catégories « droite et/ou gauche » sont anachroniques. Elles remettent en question ces attributions de partis et d’initiatives .
Je partage cette suspicion et réagis de manière particulièrement sensible lorsque cette étiquette est utilisée en permanence sans esprit critique, même dans le milieu chrétien. Ainsi, lorsque des individus ou des groupes sont qualifiés d' »évangéliques de gauche » ou de « droite » uniquement parce qu’ils agissent dans le domaine social et écologique ou qu’ils s’engagent pour des valeurs traditionnelles.
N’y aurait-il pas aussi une politisation au-delà de la gauche et de la droite ?
C’est la question que Jim Wallis a posée en 1995 dans son livre « L’âme de la politique » :
Les vieux tiroirs des idéologies politiques dominantes de progressistes et de conservateurs, de gauche et de droite, seraient également incapables de désigner clairement la crise actuelle. Les conservateurs et les progressistes ne défendent-ils pas ensemble, au fond, les grandes valeurs morales, sociales et humaines de la tradition judéo-chrétienne ? La division de ces valeurs n’est-elle pas à l’origine des polarisations et des guerres de tranchées qui en ont résulté et qui perdurent encore aujourd’hui ?
Le fait qu’au 19e siècle, les forces socio-politiques progressistes se soient alliées au matérialisme/humanisme athée est malheureusement aussi dû au fait que la plupart des chrétiens et des églises ont cultivé pendant des décennies l’absurde opposition factice entre « politique sociale » et « Évangile ». Les quelques personnalités de la « mission intérieure » (Joh. Hinrich Wichern +1881) et du mouvement socio-religieux (Christoph Blumhardt +1919, Hermann Kutter +1931, Leonhard Ragaz +1945) n’ont malheureusement pas réussi à empêcher cela à l’époque.
Le schéma droite-gauche s’effiloche
Ainsi, le schéma droite-gauche marque notre conscience politique et sociale comme une grille de classement immuable.Pourtant, il semble ne plus être adapté.
C’est ce qu’a montré la tactique des partis avec des sous-listes et des listes composées pour les dernières élections au Conseil national en octobre 2023. Qui s’est allié avec qui, pourquoi et comment – on ne pouvait qu’être étonné ! Des suppositions, des secousses de tête et de la malveillance critique se sont manifestées, car cela ne correspondait pas du tout à notre besoin de coordonnées fiables.
Un nouveau mélange inhabituel émerge à l’échelle mondiale
Cette confusion de l’année dernière dans le paysage des partis n’est pas un cas particulier helvétique, mais un phénomène européen et transatlantique. Elle reflète un changement d’époque qui a commencé avec la chute du mur de Berlin en 1989. Les anciennes catégories idéologiques conservateur-traditionnel-national et progressiste-multiculturel-mondial s’effritent, tout comme l’ancienne opposition entre capitalisme et communisme.
La Chine montre par exemple à quel point un communisme capitaliste peut être efficace s’il n’est pas miné par la corruption.
Une politique idéologisée telle qu’elle a été menée jusqu’à présent empêche depuis longtemps des stratégies communes de gestion des multi-crises et de désescalade des conflits internationaux.
Actuellement, nous voyons des autocrates narcissiques, des oligarques suffisants et des hommes de pouvoir égomaniaques utiliser ces idéologies uniquement à des fins de propagande, pour créer des images d’ennemis et rendre ainsi leur nation – non, eux-mêmes – plus grande. Et le monde commence à chanceler dangereusement.
Dans quelle direction cela va-t-il aller ?
Les problématiques actuelles « ne se laissent plus si facilement situer sur l’ancien axe de coordonnées politiques entre la droite et la gauche » . En effet, nous ne sommes plus seulement mis au défi sur le plan économique et financier, mais aussi sur le plan politique, culturel, socio-éthique, normatif, existentiel et, depuis peu, numérique/médiatique, avec une intensité sans précédent. Cette diversité interactive autodynamique fait voler en éclats toute explication monocausale.
La politisation idéologiquement unilatérale, conservatrice ou progressiste, doit maintenant dévoiler d’urgence quels intérêts jouent en réalité encore un rôle puissant.
Il est devenu particulièrement inquiétant de voir comment l’intolérance se radicalise actuellement précisément chez ceux qui revendiquent la tolérance. Les politiques et les parlementaires, les scientifiques et les journalistes déplorent la polarisation parfois haineuse et la culture du soupçon de plus en plus agressive qui se développent depuis la pandémie et qui dépassent totalement les anciens clivages droite-gauche .
L’adversaire politique reste un semblable
Dans notre démocratie directe, la foi chrétienne est en permanence confrontée à des décisions politiques. Elle est d’autant plus appelée à briser les vieilles polarisations et les oppositions idéologiques et à les surmonter par une vision globale que nous trouvons de manière exemplaire chez les prophètes de l’Ancien Testament et bien sûr chez Jésus : Il ne s’agit pas de pouvoir, de profit et de « vouloir être grand », mais de servir une humanité globale.
La foi chrétienne analyse de manière critique la politique nationale ainsi que la réalité internationale et mondiale et remarque alors rapidement à quel point le schéma traditionnel « droite-gauche » semble dépassé et sans perspective. Il ne correspond tout simplement pas aux critères bibliques pour une politique de paix, de justice et de préservation de la création.
Qu’est-ce qui pourrait faire bouger une politique qui s’oriente en dernier lieu – ou du moins de manière minimale – vers le message, l’attitude et le comportement de Jésus ? Bien sûr, il est extrêmement difficile de mettre en œuvre politiquement l’amour du prochain de classe à classe, de parti à parti, de race à race, de religion à religion et de nation à nation. Mais toute tentative, aussi minime soit-elle en apparence, nous permettrait de découvrir une culture politique « au-delà de la droite et de la gauche », une « troisième voie », un « nouveau centre », un nouveau comportement, une nouvelle liberté par rapport aux préjugés idéologiques.
Et il y a déjà eu, et il y a toujours, des hommes et des femmes politiques qui, au-delà de leur appartenance à un parti, agissent comme des bâtisseurs de ponts et qui allient leurs compétences et leurs convictions politiques à une volonté de dialogue ouvert. Leur lutte argumentée dans le dialogue permet de se comprendre et de se respecter mutuellement. Toute communication politique décente et sérieuse, sans méchanceté, crée une atmosphère dans laquelle mon adversaire politique n’est pas un ennemi, mais reste un semblable ! Le refus de dialoguer est dangereux pour une démocratie, il empêche une politique factuelle orientée vers des solutions et favorise une politique de pouvoir subtile.
Ne pensez plus dans des tiroirs – s’il vous plaît !
Je sais que la formule linguistique « droite/gauche » ne peut pas encore être supprimée.
Je la retrouverai demain et après-demain dans les informations et les médias, comme elle l’a toujours été. Mais celui qui bannit cette pensée à tiroirs de sa culture de pensée, puis de son activité politique quotidienne, élève sa pensée et son action politiques à un autre niveau – plus élevé. Et cela aura des conséquences durables.
Toute tentative timide est à saluer et à soutenir absolument !
Récemment Martin Notter : « La répartition entre conservateurs et progressistes suit une logique de parti. Avec un Conseil de l’avenir, il y a une chance que cette logique soit dépassée (TAMagazine 34/2023).
Jim Wallis, L’âme de la politique. Une vision pour un renouveau spirituel de la société. Munich 1995. p.50-69
Robert Habeck, Von hier an anders. Cologne 2021. p.68. A partir de la page 240, Habeck lutte pour une politique de la communauté dans une différence à supporter, au-delà de la pensée traditionnelle des camps.
Edgar Schuler, La Suisse est fortement polarisée en comparaison internationale. TA 9.8.2023
Cet article a été publié pour la première fois le 01 octobre 2023 sur Insist Consulting. Il a été légèrement remanié pour ChristNet.
Foto de Pablo García Saldaña sur Unsplash