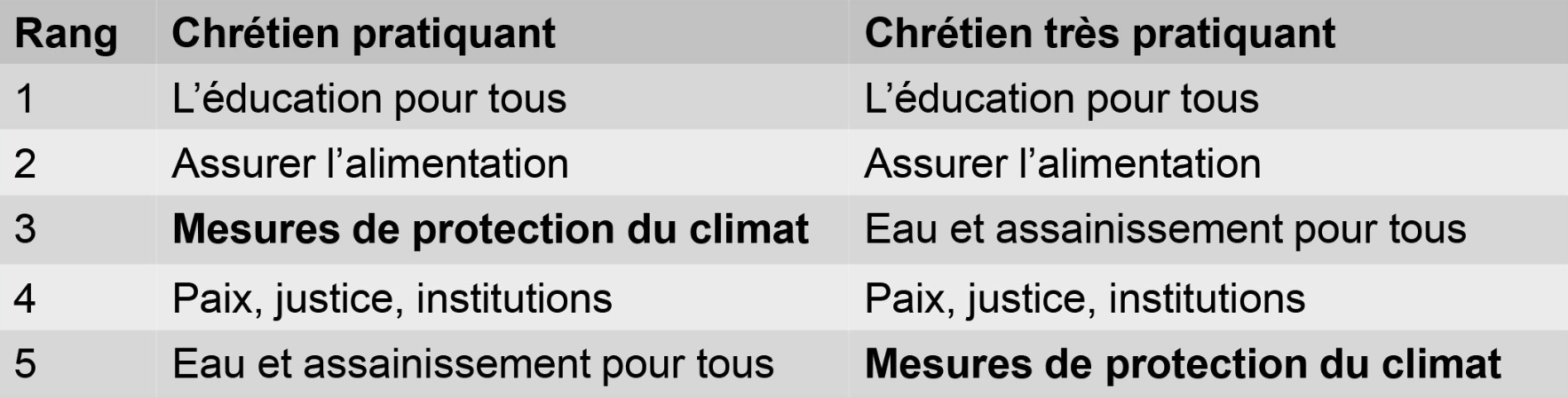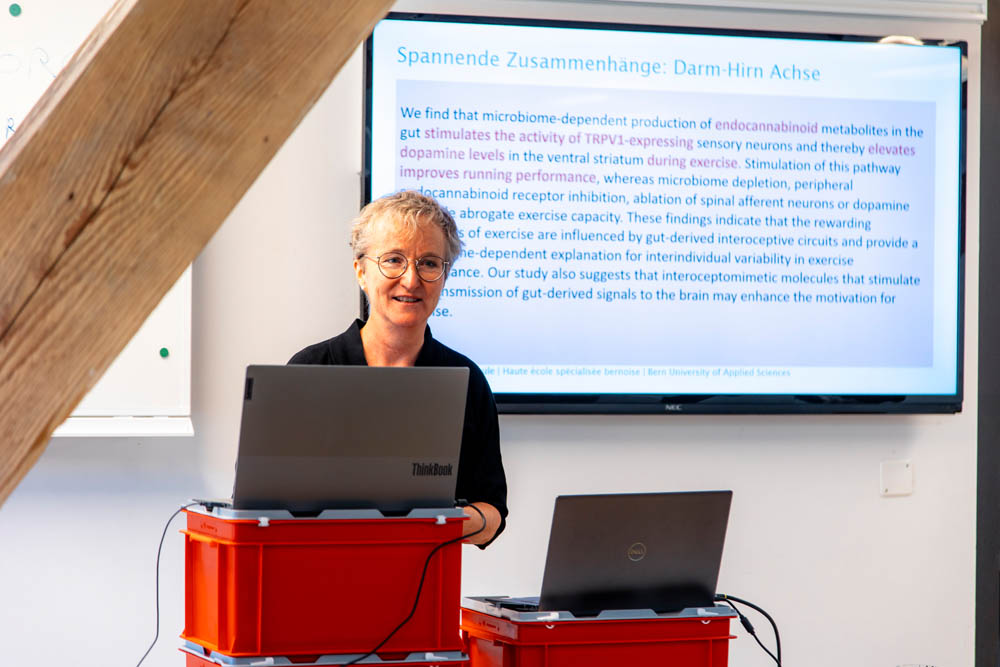~ 14 minLa popularisation mondiale d’Internet dans les années 90 a été un véritable exploit. Le courrier électronique permettait soudain de joindre facilement des amis et de leur transmettre des documents ; les sites web permettaient de diffuser le message de son entreprise ou de son institution auprès d’un public plus large. Avec les médias sociaux, l’IA et la falsification des images et des sons, ce monde fascinant de l’information a perdu son innocence. Aujourd’hui, une société de désinformation menace et devient un danger croissant pour nous tous. Existe-t-il des issues ?
En tant que journaliste, j’ai participé dès le début à la mise à disposition d’Internet pour tous. Le sifflement et le bourdonnement lors de l’établissement d’une connexion ne fascinaient pas que moi, mais aussi mes enfants. Je les ai introduits peu à peu dans ce monde fascinant. Au début, cela allait de pair avec une limite de temps stricte. Ceux qui voulaient rester plus longtemps sur Internet devaient le payer avec leur propre argent de poche.
Pour la diffusion du message chrétien, de nouvelles possibilités s’ouvraient d’un coup, en particulier dans les régions peu développées de notre monde. Dès que les connexions Internet étaient disponibles, le missionnaire ne devait plus nécessairement être présent en personne. Il pouvait facilement transmettre ses textes – comme les traductions de la Bible – par voie numérique. Il est devenu possible de proposer des cours numériques à une large population, même dans le Sud du monde. Un nouveau monde de l’information !
L’âge d’or de Facebook
Pour l’étudiant Mark Zuckerberg et ses amis, Facebook n’était au départ qu’un gag destiné à attiser la concurrence pour attirer les jolies étudiantes. Mais il a rapidement senti qu’il était possible de faire plus avec les médias sociaux. Finalement, le tout pouvait être associé à la publicité et ainsi être financé. En 2007, le CEO de Facebook, âgé de 23 ans, était déjà milliardaire. En bourse, la jeune entreprise attirait de plus en plus l’attention des capitalistes. En peu de temps, Facebook valait 15 milliards de dollars.
Au début, il n’y avait pas encore de fonction « J’aime », « personne ne pouvait mesurer sa valeur personnelle aux pouces cliqués par les autres « . Le défilement infini n’existait pas non plus.Une fois que l’on avait lu toutes les réactions de ses connaissances, la contribution saisie – le post – était arrivée à sa fin. »Aucun algorithme ne contrôlait les messages, ils apparaissaient simplement dans l’ordre dans lequel ils avaient été publiés ».
Jessica King décrit ainsi cette période faste de Facebook : « Il ne s’agissait pas non plus de plonger dans un monde parallèle manipulé dans lequel toutes les autres personnes mènent des vies apparemment plus passionnantes.Au lieu de cela, nous utilisions la plate-forme pour participer au quotidien banal des autres, … créer des groupes avec des noms amusants, … se souhaiter un bon anniversaire et rechercher les profils de personnes que l’on ne voyait habituellement que de loin à l’université. C’était un outil pour créer et intensifier les liens ».Donc un effet similaire à celui qui avait été amorcé avec l’introduction d’Internet.
Le début de la fin
Le 9 février 2009, Facebook a introduit le bouton Like.
Jessica King a réagi en publiant le message suivant : « Ceux qui aiment ce post sont stupides ».La réaction a été immédiate : « Plusieurs personnes ont déjà cliqué sur le petit pouce, et pour la première fois, j’ai ressenti le petit coup de dopamine de l’affection numérique. Bientôt, je me suis demandé pourquoi certains posts fonctionnaient mieux que d’autres, j’ai essayé d’optimiser mes performances.Je me comparais aux autres et ressentais une légère pointe de honte lorsque j’obtenais moins de likes que mes camarades d’études ».
Parallèlement au lancement du bouton « Like », Facebook a atteint un million d’utilisateurs en Suisse.Désormais, la plateforme était de plus en plus dirigée. Jessica King constate que Facebook associait de plus en plus souvent d’autres formats à ses propres contributions, avec « des publicités, des actualités et des contributions de pages jusqu’alors inconnues, ‘qui pourraient me plaire' ». En 2011, Facebook a décidé de ne plus lister les contributions étrangères par ordre chronologique, mais sous le contrôle d’algorithmes.C’est ainsi qu’a commencé le défilement interminable à la recherche d’une contribution encore plus passionnante sur le sujet.Jessica King décrit ainsi son expérience : « Je restais désormais de plus en plus longtemps assise devant l’écran, faisant défiler et défilant, prise dans le monde du géant bleu ».
Mark Zuckerberg a alors commencé à développer son entreprise. Il a avalé des concurrents comme Instagram et Whatsapp et a payé respectivement 1 et 19 milliards de dollars pour cela. « Le fait que le profit devienne de plus en plus important, nous le ressentions au quotidien », explique Jessica King à ce sujet. »Alors qu’au début Facebook diffusait encore une esthétique austère, la plateforme a été de plus en plus bardée de publicités tapageuses, de flux déroutants et de sidebars incontrôlables ».
Lorsque le printemps arabe a éclaté en 2011, Facebook et son concurrent Twitter ont porté les protestations de Tunisie dans le monde entier. Jessica King se réjouit : « On croyait de plus en plus au pouvoir politique de Facebook – on pouvait même renverser des dictateurs avec lui ! Nous avons posté notre soutien, utilisé pour cela à partir de 2013 des hashtags que Facebook avait introduits, et nous pensions avoir aidé les opprimés du monde entier grâce à cet activisme numérique ».
En 2014, le symbole # a été élu mot de l’année en Suisse. En 2014, les hashtags les plus importants n’étaient pas des thèmes liés à l’injustice dans notre monde, mais par exemple #IceBucketChallenge. Sous cette adresse, des personnes du monde entier se sont vidées de l’eau glacée sur la tête et ont documenté leur geste par un clip vidéo, dans l’espoir d’obtenir le plus de likes possible. Parmi les hashtags les plus connus figure #MeToo, qui s’est répandu sur les réseaux sociaux depuis la mi-octobre 2017 dans le sillage du scandale Weinstein et a déclenché un mouvement social en faveur des droits des femmes en cas d’agression sexuelle.
Avec les nouvelles possibilités mentionnées, la plateforme Facebook était toutefois devenue incontrôlable.Les abus se sont généralisés. Jessica King déclare à propos de l’évolution de 20 ans de Facebook que la plateforme Internet s’est transformée d’un charmant village numérique en un danger pour les démocraties, et que Mark Zuckerberg est passé d’un jeune entrepreneur enfantin à un surcapitaliste au sang froid qui doit s’expliquer devant le Congrès américain.
Chez Google, les données de chaque requête de recherche sont enregistrées. « Cela inclut la localisation, les termes de recherche, le comportement de recherche et les clics sur les pages web », écrit Debby Blaser dans le magazine INSIST. « Sur de nombreux sites web, les utilisateurs sont ‘suivis’ en enregistrant, à l’aide de l’adresse IP, qui a visité le site web. Grâce à ces données, il est possible d’afficher sur Facebook, dans une publicité, exactement la basket que j’ai regardée récemment sur Zalando. Ce qui est pratique pour les annonceurs, certains utilisateurs le considèrent toutefois comme une intrusion dans leur vie privée« .
Les médias asociaux deviennent un terrain de jeu pour les indignations
Les médias sociaux permettent aux utilisateurs de se faire rapidement une opinion sur tous les sujets possibles et imaginables et de la partager ensuite avec d’autres. En cas d’approbation massive, la diffusion de cette opinion s’accroît et peut déclencher des processus qui ne peuvent plus guère être contenus.
La journaliste Alexandra Föderl-Schmid, spécialiste du Proche-Orient au « Süddeutsche Zeitung », a récemment tenté de se suicider. Il lui a été reproché d’avoir, dans au moins trois cas, repris in extenso des explications d’institutions publiques sans le déclarer en conséquence. Elle aurait ainsi commis un plagiat – un péché mortel pour les journalistes. Le portail allemand « Nius » a alors engagé le « chasseur de plagiat » Stefan Weber pour découvrir d’autres plagiats, notamment dans la thèse de la journaliste. Weber réalise des expertises sur des travaux universitaires contre de l’argent. « Les analyses de Weber mettent régulièrement des personnes célèbres en difficulté », écrit à ce sujet la journaliste Raphaela Birrer, qui ajoute : « Souvent, ses accusations sont toutefois injustifiées ».
Pour elle, dans de tels débats et expertises, « il ne s’agit plus depuis longtemps d’honnêteté intellectuelle ou de normes universitaires.Il s’agit de motifs politiques, de vendetta, de diffamation ».
Les médias asociaux se prêtent parfaitement à la diffusion de ces indignations. Bien qu’une enquête ait montré que les accusations concernant la thèse d’Alexandra Föderl-Schmid n’étaient pas fondées, des commentaires haineux ont été publiés, préconisant la tentative de suicide et des attaques personnelles de mauvais goût. Les opinions étaient déjà faites et ne se laissaient pas ébranler par quoi que ce soit. Raphaela Birrer commente l’indifférenciation et l’indignation suscitées par le cas Föderl-Schmid : « Elles fournissent involontairement une leçon d’illustration de l’évolution dégénérative des débats numériques. Et ils montrent qu’il est actuellement difficile, voire impossible, de discuter …de mener des débats sereins. Pas même lorsqu’un discours a des conséquences presque mortelles« .
L’intelligence artificielle et le piratage renforcent le problème
L’intelligence artificielle peut aider à rendre les processus automatiques plus rapides. Mais si elle est utilisée sur Internet, les problèmes mentionnés risquent de s’aggraver. On nourrit l’IA avec un visage et une voix.
A partir de ces données, l’IA crée ensuite une matrice qui sert de modèle pour chaque version ultérieure.
En mars dernier, une vidéo montrant le président ukrainien Volodimir Selenski demandant à ses troupes de déposer les armes et de se rendre à la Russie a circulé, écrit Andrian Kreye. Mais il est tout de suite apparu « que quelqu’un avait monté sa tête sur un tronc « .
Dans un autre exemple, le footballeur Lionel Messi parle un anglais compréhensible lors d’une conférence de presse, bien qu’il s’exprime toujours en espagnol. La technologie sous-jacente s’appelle le clonage vocal, qui a été combiné à l’IA des traducteurs. Un exemple plutôt anodin.
Mais lorsque des contrefaçons (deepfake) sont utilisées pour générer des photos nues de la star de la pop Taylor Swift dans un but pornographique, cela constitue une atteinte à la personnalité au plus haut degré. Il n’est pas rare que la pornographie deepfake soit également utilisée à des fins de chantage.
Ce qui nous amène au plus bas de l’échelle : la possibilité de pirater Internet et d’accéder ainsi à des données confidentielles – que ce soit pour faire chanter des entreprises ou diffuser de faux messages. Ces attaques de pirates informatiques augmentent de manière exponentielle, y compris en Suisse. En 2022, le Centre national de cybersécurité de la Confédération a reçu 34 000 déclarations de cyberincidents, soit trois fois plus qu’en 2020. Selon le journaliste Michael Bucher, « on prévoit pour 2025 un montant mondial de dommages dus aux cyberattaques de près de 11 billions de francs.
Cela représenterait des coûts environ 40 fois plus élevés que ceux causés par les catastrophes naturelles en 2022« .
Lors du récent Forum économique mondial de Davos, les fake news ont été désignées comme le plus grand danger pour l’humanité au cours des deux prochaines années. Les fausses informations sur Internet pourraient diviser davantage la société. « Avec des technologies telles que ChatGPT ou les nouvelles versions de Photoshop, il est facile de créer des textes ou de falsifier des images « . De cette manière, « les fausses informations diffusées de manière ciblée peuvent influencer les prochaines élections aux États-Unis ».
Cela pourrait susciter des doutes sur les gouvernements nouvellement élus et déclencher des troubles politiques. Un danger pour la démocratie !
Que pouvons-nous faire ?
Sur le chemin qui mène de l’information à la désinformation, la vérité reste sur le carreau : nous suivons le mensonge. Le profane bien-pensant ne s’y attardera pas. Grâce aux informations qui lui sont transmises par son profil, il sait ce qu’il en est.
Le scepticisme croissant à l’égard de la science y est lié. En 2016, selon une étude américaine, 44 % du grand public étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle « les experts sont moins fiables que les profanes ». Mais lorsque des profanes s’érigent en spécialistes, l’ignorance règne en maître. « Et sur la toile, ce sont les plus bruyants, avec le plus grand nombre de followers, qui déterminent ce qu’est la vérité ».
Suivre le père du mensonge ne peut toutefois pas être une option pour les chrétiens.
Que faut-il donc faire ? Des leaders religieux et de foi de Grande-Bretagne ont constaté, après une récente réunion sur les questions éthiques liées à l’IA, que les communautés de foi et les organisations de la société civile devaient agir en tant que « gardiens critiques qui demandent des comptes aux développeurs d’IA ainsi qu’aux décideurs politiques ». Lors d’une prochaine réunion, ils souhaitent mettre en place une commission « dont l’objectif est d’exploiter les possibilités de l’intelligence artificielle pour le bien-être humain tout en protégeant les communautés contre les dommages potentiels « .
Cette protection peut être garantie par des institutions qui ont une légitimité démocratique. Le conseiller national UDC Andreas Glarner a utilisé une fausse vidéo contre son adversaire politique Sibel Arslan des Verts. Quelques jours avant les élections parlementaires de l’année dernière, Glarner a publié sur X et Instagram une vidéo trompeuse d’Arslan, générée au moyen d’une intelligence artificielle.
Dans cette fausse vidéo, elle a ensuite exprimé des opinions qui allaient à l’encontre de ses convictions réelles. Arslan a porté l’affaire devant les tribunaux. Selon un récent jugement du tribunal civil de Bâle-Ville, Glarner doit prendre en charge les frais de justice et les frais d’avocat d’Arslan dans cette affaire. Elle envisage actuellement, comme prochaine étape, de déposer une plainte pénale contre Glarner. Celle-ci pourrait devenir le précédent d’un nouveau délit qui n’est en vigueur que depuis le 1er septembre 2023 : le délit d’usurpation d’indentité.
Quelques heures seulement après l’attaque terroriste du Hamas contre Israël en octobre dernier, des photos et des vidéos manipulées d’autres guerres ont circulé sur la plate-forme X. On y trouvait même des séquences de jeux vidéo et des images de feux d’artifice du Nouvel An. Les utilisateurs ont diffusé ces images pour faire monter la température contre Israël ou contre les Palestiniens. « X, la plus grande source mondiale d’informations en temps réel, agit ces jours-ci comme un centre de distribution de nouvelles trompeuses », écrit Jan Diesteldorf.
L’UE veut maintenant inculper le propriétaire de X, Elon Musk, qui avait promis de respecter les règles européennes en matière de services numériques. Selon celles-ci, X devrait « réagir rapidement, soigneusement et efficacement aux indices, supprimer les contenus illégaux et ‘lutter efficacement contre les risques pour la sécurité publique et le discours social émanant de la désinformation' ».
« Les médias classiques perdent le contrôle du cycle de l’information et les algorithmes semblent diffuser plus rapidement des informations parfois fausses et sensationnelles », a expliqué Silke Adam, professeur à l’Institut des sciences de la communication et des médias, lors d’un atelier à l’université de Berne l’automne dernier. Elle en concluait : « La désinformation met en danger notre démocratie et peut être un déclencheur de polarisation des gens« .
On peut en conclure que nous ne devrions pas perdre de vue les médias classiques, en particulier les médias tels que la télévision ou la radio publiques et la presse écrite indépendante des partis. Ceux-ci devraient être en mesure de présenter des faits plutôt que des fake, afin que nous puissions nous forger une opinion de manière plus fiable, si possible en combinant plusieurs médias.
Ce que l’on oublie souvent : l’IA est liée à une violation du droit d’auteur.
Un procès est actuellement en cours entre le « New York Times » et le fournisseur d’IA Chat-GPT. Celui-ci avait fait passer des copies de textes en partie littérales pour des textes d’IA. Gary Marcus, professeur de neurosciences à l’université de New York, a lui-même créé plusieurs entreprises pour des applications d’IA. Il est aujourd’hui considéré comme la voix de la raison dans le débat sur l’IA. Il ne voit pas de solutions rapides : « Tant que personne n’inventera une nouvelle architecture permettant de suivre de manière fiable l’origine de textes ou d’images générés, les violations de droits continueront d’exister« .
Il y a tout de même de premiers progrès. Celui qui a demandé sur Chat-GPT les bases d’un développement de village axé sur les valeurs a reçu une réponse dont le contenu m’a semblé très familier. En tapant la même demande sur Copilot, on obtient également des réponses tirées des publications du WDRS, mais cette fois-ci avec une indication propre de la source et des liens vers les contributions originales, par exemple dans notre forum.
Nous sommes libres d’adapter notre comportement médiatique à la nouvelle situation. Debby Blaser fait remarquer qu’il existe des alternatives aux moteurs de recherche comme Google, qui n’enregistrent pas de données et ne vendent pas d’informations à des tiers, comme Swisscows ou DuckDuckGo.
La présence de Facebook est aujourd’hui en baisse.
Mais même ses successeurs et ses alternatives ne sont pas beaucoup plus performants en termes de données et d’abus. Mastodon est censé être, du moins dans son principe, une construction de médias sociaux nettement différente : il n’y a pas de serveur central et donc pas de propriétaire ayant des intérêts économiques précis, ni d’algorithme de recommandation pour le flux. L’application de messagerie Threema est considérée comme une variante plus sûre de WhatsApp. Selon sa propre publicité, elle protège les données personnelles « de l’accès par les pirates, les entreprises et les gouvernements ».
Le monde numérique s’oriente aujourd’hui vers des intérêts de pouvoir et financiers, même s’il doit pour cela sacrifier la vérité. Cela ne doit pas nous empêcher d’utiliser les possibilités positives d’Internet pour diffuser des contenus de qualité, basés sur des faits. En même temps, nous pouvons contribuer à ce que les tendances négatives soient mises en lumière et combattues.
Tout commence avec nos enfants
Enfin, nous devrions peut-être prendre du recul par rapport à nos médias numériques. La neuroscientifique Maryanne Wolf plaide pour la redécouverte de deux anciennes disciplines : la lecture et la pensée. De son point de vue, les médias numériques menacent ces deux aspects.
Selon elle, l’étude Pisa actuelle a constaté une tendance à la baisse des capacités de lecture chez les jeunes de 15 ans dans le monde entier.
C’est pourquoi Maryanne Wolf déclare : « De zéro à cinq ans, les enfants devraient être entourés de livres (d’images), les parents et l’entourage devraient leur lire des histoires tous les jours, les enfants devraient tenir leurs livres, jouer avec, voire les mâchouiller ! La lecture doit être une expérience interactive et sensorielle ». On peut ensuite introduire les écrans de manière très progressive entre un an et demi et cinq ans. Ils ne devraient toutefois pas remplacer la baby-sitter, ni comme distraction, ni comme récompense ou punition. Dès que les enfants peuvent apprendre à lire par eux-mêmes, il est judicieux de faire coexister l’imprimé et le numérique, également pour soutenir la lecture. À l’âge de sept ou dix ans peut-être, l’école pourrait alors introduire les enfants dans le monde de la lecture approfondie. « Si nous ne faisons qu’écumer et que nous avons du mal à distinguer l’information de la désinformation, nous finirons par mettre en danger notre cohabitation démocratique « , estime la spécialiste du cerveau.
En bref : peut-être pourrions-nous nous-mêmes reprendre un livre. Outre la Bible, il peut tout à fait s’agir d’un bon roman – ou d’un ouvrage spécialisé sur les théories du complot.
Comme je ne me suis pas laissé séduire jusqu’à présent par la participation aux médias sociaux, je suis généralement dans cette partie les réflexions de la journaliste Jessica King dans « Der Bund », 12.2.24
clôture de jardin allemande avec le symbole #.
Magazine INSIST, avril 2018
« Der Bund », 13.2.24
« Der Bund », 18.9.23
« Der Bund », 10.2.24
« Der Bund », 21.2.24
Anna Lutz dans le magazine Pro-Medien du 10.1.24
« Der Bund », 11.12.23
Livenet, 14.11.23
« Der Bund », 6.1.24
« Der Bund », 12.10.23
« Der Bund », 20.10.23
« Der Bund », 13.1.24
Magazine INSIST, avril 2018
https://www.watson.ch/digital/review/279309107-twitter-alternative-17-gruende-warum-sich-mastodon-auch-fuer-dich-lohnt
« Der Bund », 21.12.23
Cet article a été publié pour la première fois le 01 mars 2024 sur Forum Integriertes Christsein (en allemand).
Photo de dole777 sur Unsplash